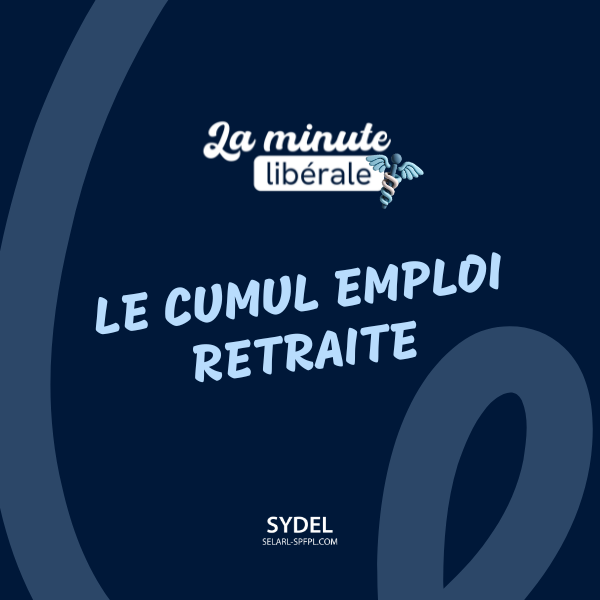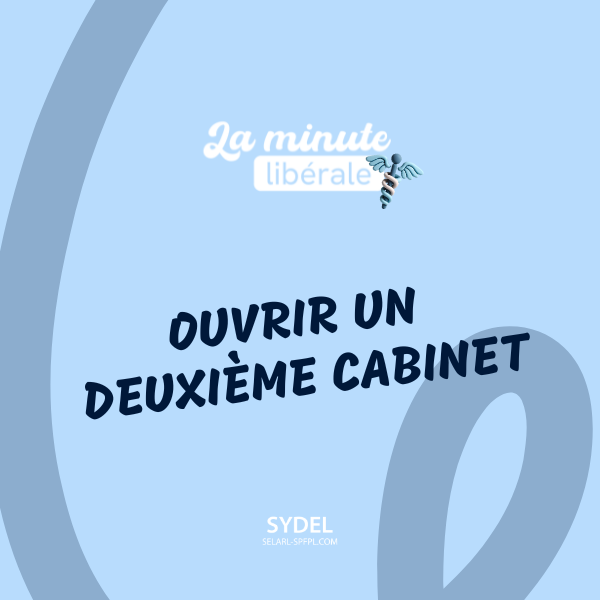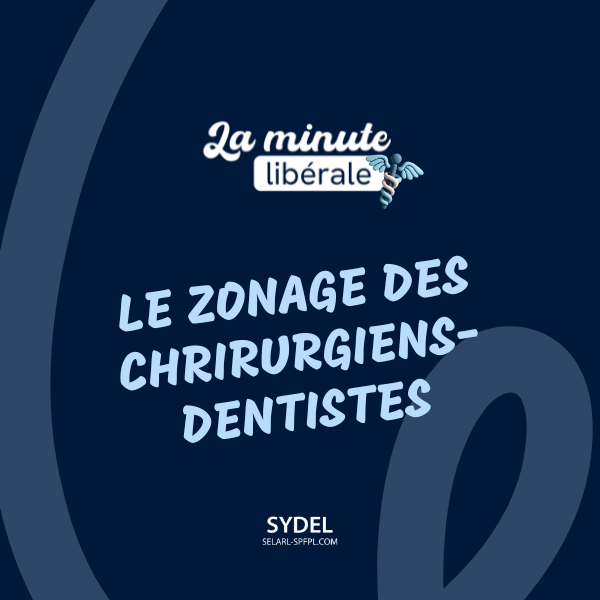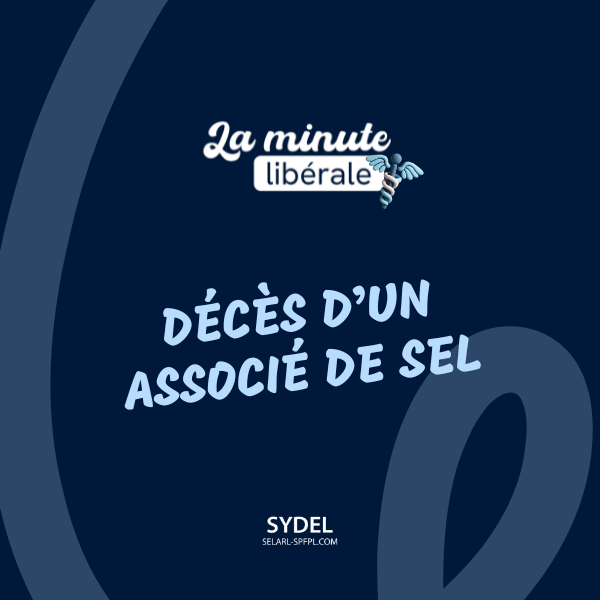Collaboration libérale et association : le cadre juridique et pratique pour les médecins et dentistes libéraux
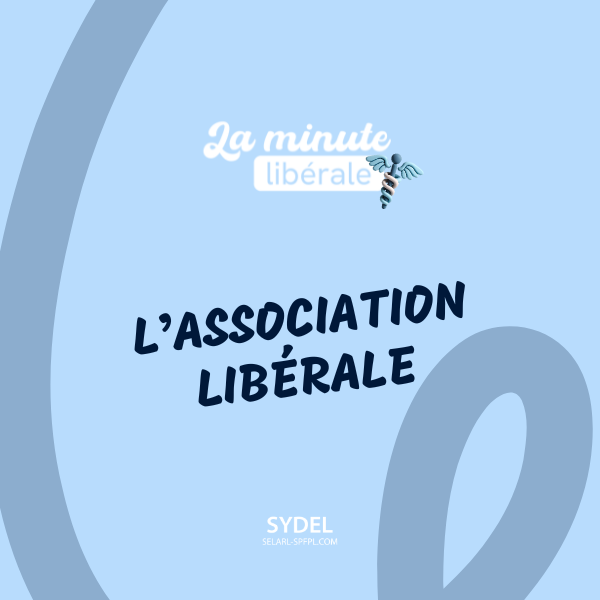
La collaboration libérale est devenue une étape essentielle dans la carrière des professionnels de santé. Pour un médecin ou un dentiste, elle permet de s’intégrer dans un cabinet existant tout en conservant son indépendance professionnelle.
Mais au-delà de cette première expérience, la collaboration est souvent le tremplin vers une future association. Comprendre ses modalités, ses obligations et ses enjeux juridiques est donc indispensable pour sécuriser son parcours et préparer l’avenir.
Le cadre juridique de la collaboration libérale
La collaboration libérale repose sur un contrat écrit conclu entre un praticien titulaire et un collaborateur libéral. Ce dispositif, prévu par les articles L. 4113-9 et suivants du Code de la santé publique, encadre l’exercice des médecins, dentistes et autres professions réglementées.
Le collaborateur exerce à titre indépendant : il gère son emploi du temps, ses honoraires et sa patientèle personnelle, tout en profitant des moyens du cabinet.
Un contrat encadré et validé par l’Ordre
Le contrat de collaboration libérale doit obligatoirement être rédigé par écrit et transmis à l’Ordre professionnel avant toute prise d’effet.
Il précise notamment la durée, les conditions d’exercice, la redevance, les modalités de rupture et la liberté d’installation du collaborateur après le contrat.
Les modèles proposés par les Conseils nationaux de l’Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes offrent un cadre de référence, mais doivent toujours être adaptés à la situation du cabinet.
Une relation fondée sur l’indépendance
Le collaborateur n’est pas un salarié : il reste maître de son activité et de ses décisions médicales.
Toute immixtion du titulaire (horaires imposés, contrôle des actes, validation préalable des soins) pourrait être assimilée à un lien de subordination, entraînant une requalification en contrat de travail.
Le respect de l’indépendance est donc la pierre angulaire de la collaboration libérale.
Les conditions essentielles du contrat de collaboration libérale
Le contrat de collaboration libérale doit impérativement être écrit et transmis au Conseil de l’Ordre avant toute prise d’effet. Les Ordres professionnels (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers) publient des modèles de contrat conformes à la réglementation. Ces modèles servent de base à la rédaction, mais doivent être adaptés à la réalité du cabinet.
Les clauses indispensables
Le contrat précise les conditions d’exercice, la durée, la rémunération et les modalités de rupture. Il mentionne notamment :
l’objet et le lieu d’exercice de la collaboration ;
la redevance et son mode de calcul ;
la durée (déterminée ou indéterminée) ;
le préavis en cas de rupture (généralement un à trois mois) ;
et, le cas échéant, la clause de non-concurrence.
Une transmission tardive ou absente du contrat à l’Ordre rend la collaboration irrégulière, exposant les deux praticiens à des sanctions disciplinaires.
Les obligations réciproques
Le collaborateur gère sa comptabilité, déclare ses revenus en Bénéfices non commerciaux (BNC), et souscrit sa propre assurance responsabilité civile professionnelle.
Le titulaire, de son côté, doit garantir au collaborateur un exercice paisible et lui fournir les moyens nécessaires (matériel, secrétariat, outils de gestion).
Les deux praticiens doivent faire preuve de loyauté et de transparence, notamment dans la répartition des charges et la gestion de la patientèle.
Les obligations du collaborateur
Le collaborateur doit respecter le règlement intérieur du cabinet, les règles déontologiques et les normes de sécurité. Il a une obligation de loyauté envers le titulaire et ne peut détourner la patientèle à la fin du contrat. En revanche, il peut, sauf clause contraire, conserver sa patientèle personnelle, qui reste sa propriété exclusive.
Les obligations du titulaire
Le titulaire doit fournir au collaborateur des moyens matériels adaptés : locaux, équipements, secrétariat, logiciels de gestion. Il ne peut lui imposer ni horaires ni directives médicales, sous peine de voir la collaboration requalifiée en contrat de travail salarié. Le respect de l’indépendance du collaborateur est une condition essentielle de validité.
De la collaboration à l’association : une évolution naturelle
Pour de nombreux praticiens, la collaboration libérale représente une étape intermédiaire avant l’association.
Elle permet de se familiariser avec la gestion d’un cabinet, de tester la compatibilité professionnelle et humaine, et de poser les bases d’un futur projet commun.
Pourquoi évoluer vers l’association ?
S’associer permet de partager les charges, de mutualiser les moyens, et d’assurer la pérennité du cabinet.
C’est également un moyen d’améliorer la qualité de vie professionnelle grâce à une meilleure répartition du travail et des responsabilités.
Lorsque la collaboration s’inscrit dans la durée, elle ouvre naturellement la voie à une association durable au sein d’une structure comme une SCM (Société Civile de Moyens) ou une SELARL (Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée).
Le pacte d’associés : un outil indispensable
Le pacte d’associés est un document stratégique qui vient compléter les statuts de la société.
Il définit les règles internes entre associés : répartition des bénéfices, prise de décision, conditions d’entrée et de sortie, préavis, cession de parts et gestion des conflits.
Un pacte bien rédigé protège la relation professionnelle et prévient les désaccords futurs.
Il est conseillé de le rédiger dès la création de la société, avec l’aide d’un juriste ou d’un expert-comptable spécialisé en droit de la santé.
Les précautions avant de s’associer
Une association ne se résume pas à un contrat : c’est un engagement humain, professionnel et financier.
Avant de franchir le pas, il est essentiel de s’assurer que les valeurs, la vision et les objectifs des praticiens sont alignés.
Bien préparer son association
Avant de signer, les praticiens doivent clarifier :
la répartition des charges et des revenus ;
la rémunération et la valorisation des parts ;
le rôle de chacun dans le fonctionnement du cabinet ;
les conditions de retrait et la procédure de séparation.
Un règlement intérieur peut compléter les statuts pour organiser le quotidien (gestion du matériel, congés, utilisation des locaux, etc.).
Anticiper la rupture
Même dans une association réussie, la prévision d’une sortie est indispensable.
Les statuts ou le pacte doivent prévoir la cession des parts, le préavis, et d’éventuelles clauses de non-concurrence.
Une séparation bien encadrée évite les litiges et protège la réputation du cabinet.
Les erreurs à éviter et les bonnes pratiques
Certains pièges peuvent compromettre la collaboration ou l’association :
absence de contrat écrit ou de validation par l’Ordre ;
répartition floue des charges et des honoraires ;
absence de communication ou divergences de valeurs ;
absence de pacte d’associés clair ;
clauses contractuelles déséquilibrées.
Pour sécuriser la relation, il est recommandé de :
s’appuyer sur des modèles conformes aux Ordres professionnels ;
faire relire le contrat ou les statuts par un juriste spécialisé ;
et maintenir un dialogue régulier entre les praticiens pour ajuster les conditions d’exercice.
Conclusion
La collaboration libérale n’est pas une simple phase transitoire : c’est une expérience structurante qui prépare à l’association.
En anticipant les aspects juridiques, financiers et humains, les praticiens peuvent construire une relation durable, fondée sur la confiance, la clarté et la transparence.
Une association réussie repose toujours sur une collaboration solide et bien encadrée.
FAQ – Vos questions fréquentes sur l'association
Le contrat de collaboration libérale est un accord écrit conclu entre un praticien titulaire et un collaborateur exerçant à titre indépendant. Il permet au collaborateur de bénéficier des moyens du cabinet (locaux, matériel, patientèle) tout en conservant son autonomie professionnelle. Il est obligatoire et doit être communiqué au Conseil de l’Ordre avant toute prise d’effet.
Le contrat doit préciser les conditions d’exercice, la redevance, la durée, les modalités de rupture et les obligations de chaque partie.
Le collaborateur doit être inscrit à l’Ordre, disposer d’une assurance responsabilité civile, et exercer dans le respect des règles déontologiques.
L’absence de contrat écrit ou sa non-validation par l’Ordre peut rendre la collaboration irrégulière.
On distingue la collaboration libérale, dans laquelle le praticien reste indépendant, et la collaboration salariée, soumise à un lien de subordination.
Seule la collaboration libérale est reconnue comme une forme d’exercice indépendante, ce qui en fait un statut privilégié dans les professions de santé.
La collaboration libérale n’implique aucun lien capitalistique : le collaborateur ne détient pas de parts dans le cabinet et n’a pas de pouvoir de décision.
L’association, au contraire, suppose une mise en commun de moyens et de décisions, souvent via une société (SCP, SELARL, SCM).
Le passage à l’association modifie le statut juridique du praticien, ses revenus, et son implication dans la gestion du cabinet.
L’évolution se prépare dès la signature du contrat de collaboration.
Les praticiens peuvent prévoir une clause d’évolution ou une option d’association à terme.
Lorsque la relation professionnelle est stable, la transformation passe par la rédaction d’un pacte d’associés définissant la répartition des parts, la gouvernance du cabinet et les règles de sortie.
Un accompagnement juridique est vivement recommandé à cette étape.
Pour acquérir ou gérer des murs professionnels, on utilise généralement une SCI (Société Civile Immobilière), souvent montée en parallèle de la SPFPL dans une stratégie patrimoniale globale.
Le pacte d’associés complète les statuts d’une société (SCP, SELARL, SCM).
Il définit les règles internes entre associés : répartition des bénéfices, gestion du cabinet, conditions d’entrée et de sortie, préavis, clauses de non-concurrence ou de rachat des parts.
C’est un outil essentiel pour prévenir les conflits et assurer la stabilité du cabinet.
Il est vivement recommandé d’en rédiger un dès la constitution de la société.
La fin d’une association peut résulter d’un accord amiable, d’un retrait d’associé, d’une cession de parts, ou d’une dissolution de la société.
Les statuts ou le pacte d’associés fixent les modalités de départ, le préavis, la valorisation des parts, et les conditions de non-concurrence éventuelles.
Une sortie bien encadrée évite les litiges et protège la stabilité du cabinet restant.
Une association mal encadrée peut entraîner des tensions entre praticiens, une mauvaise répartition des charges, ou des désaccords sur la gestion du cabinet.
Sans pacte d’associés clair, le risque de conflit augmente, notamment lors du départ d’un associé.
Une bonne anticipation juridique et un accompagnement professionnel permettent de garantir une association sereine et durable.
Découvrez nos autres articles
Cumul emploi-retraite médecins et dentistes : quelles…
Ouvrir un deuxième cabinet dentaire : ce…
Achat des murs de son cabinet :…
Décès associé SELARL : comment assurer la…
Collaboration libérale : évitez les erreurs d’association
SYDEL SARL au capital minimum de 812 000€, RCS Paris : 788 531 432 00037, Code APE/NAF : 6619 B, N° TVA : FR18788531432
Enregistré sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°120 69 007 en qualité de : Conseiller en investissements financiers adhérent à L’ANACOFI-CIF association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, Courtier en opération d’assurance dans la catégorie « b », Courtier en opérations de banque et services de paiement, Activité de démarchage bancaire et financier, et Agent immobilier, Carte de Transaction Immobilière n° CPI 7501 2018 000 038 570 délivrée par la CCI – La société ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeur, Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties Financières souscrites auprès de : AIG EUROPE LIMITED, Siège social Tours CB21-16, n°2.401.395/OC 100 000 394.
©2025. Sydel Office